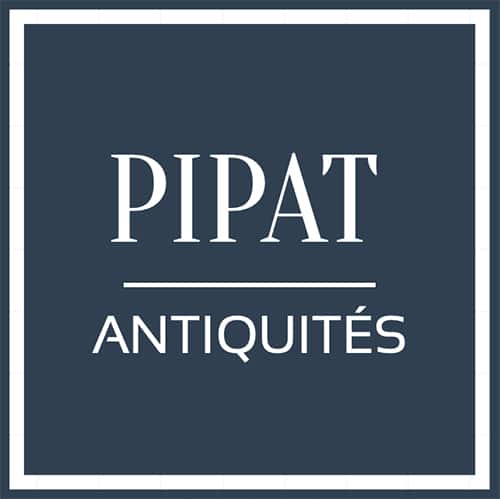Les poinçons d’Ancien Régime : complexes mais précis
Il est trop souvent oublié qu’argenterie et orfèvrerie sont, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, des réserves monétaires. Souvenons-nous de Louis XIV qui fit fondre toutes les pièces de son sublime mobilier d’argent pour financer ses guerres ! Trône, torchères, cassolettes et vases, tout passa à la fonte en 1689. Il en était ainsi depuis le XIIIe siècle. Quiconque souhaitait obtenir des liquidités en échange de son argenterie devait seulement se rendre à l’Hôtel des Monnaies qui échangeait alors contre des espèces le poids de métal fin contenu dans la pièce qui lui était apportée. Or les contentieux ne furent pas longs à surgir car les orfèvres fabriquaient eux-mêmes leurs alliages et tous n’étaient pas de la meilleure probité. Ainsi, certains clients eurent la désagréable surprise de découvrir qu’une pièce payée fort cher pour son poids en métal précieux n’était pas, selon l’Hôtel des Monnaies, aussi riche que l’orfèvre l’avait prétendu lors de la vente !
Il fallut donc élaborer un système permettant de limiter les fraudes et de responsabiliser les artisans. Ainsi apparurent les poinçons, et ce dès 1272.
Les poinçons évoluèrent et évoluent encore. Alors qu’il n’existait qu’un seul poinçon au XIIIe siècle (celui de la Maison Commune, c’est-à-dire le pouvoir municipal), i les fallait deux en 1378 (celui de la Maison Commune sous forme de lettre date couronnée nommée « poinçon de jurande » et celui de l’orfèvre). Ainsi pour l’année 1603, le poinçon de jurande de la ville de Paris est un F couronné.
À partir de 1672, Colbert (1619 – 1683) réforme le système en place pour imposer un système à quatre poinçons ; système qui restera en vigueur jusqu’en 1790. Pour chaque pièce en or, argent ou vermeil (argent doré), il faudra apposer les poinçons suivants dont la taille et le dessin variaient selon les ouvrages :
- Le poinçon de maître est frappé par l’artisan sur l’ébauche de la pièce. Il comprend ses initiales avec son emblème personnel et parfois celui de sa ville.
- Le poinçon de charge est appliqué par la Ferme générale (qui prend en charge les recettes des impôts indirects), son aspect change tous les deux ou trois ans.
- Le poinçon de jurande (de la Maison commune) était appliqué par les jurés-gardes de la corporation. Le poinçon prenait la forme d’une lettre changeant chaque année par ordre alphabétique
- Le poinçon de décharge était apposé par la Ferme générale une fois la pièce achevée et après le paiement de la taxe. Il prend la forme d’un petit animal.
Parfois certaines pièces ne sont pas marquées des poinçons de la Ferme générale. On peut l’expliquer par la fraude de quelques orfèvres téméraires désireux de se soustraire à ces poinçons pour ne pas avoir à payer de taxe. Néanmoins, la pratique était risquée et le fraudeur encourrait de lourdes peines.
Notons également que ces quatre poinçons devaient être apposés sur toutes les parties de l’objet y compris ses parties mobiles comme le couvercle. Pourtant, certaines juridictions « oublièrent » cette obligation très respectée à Paris. Cela n’en dévalorise pas pour autant la pièce concernée.
Quelques bizarreries apparaissent parfois. Le poinçon au C couronné sur les ouvrages de bronze doré en est un exemple. Gage pour les collectionneurs d’une pièce de qualité, ce poinçon se lit comme la récompense d’un travail de qualité. Il semble que ce poinçon rare n’ait été insulpté que sur les bronzes les plus raffinés. Ce poinçon d’impôt créé sous Louis XV (1710 – 1774) couronne donc les pièces qui en sont frappées d’une reconnaissance artistique mais garantit également la rareté et la qualité de ces ouvrages.
Les poinçons après la Révolution française : Vieillard, Coqs et Minerve
À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution ne vient pas seulement bouleverser la vie politique du royaume de France. C’est toute une société qui est profondément chamboulée dans son organisation sociale et économique. Le système des poinçons est aboli mais il faudra bien quelques années plus tard en établir un nouveau pour éviter les fraudes et les contrefaçons. En 1797, ce nouveau système est mis en place et s’avère plus simple que le précédent.
Ce sont désormais trois poinçons qui sont apposés sur les pièces d’orfèvrerie et d’argenterie :
- Le poinçon de maître en forme de losange (ou dans un ovale si la pièce est importée)
- Le poinçon de garantie
- Le poinçon de titre : il indique le rapport de la masse de métal précieux à la masse totale de l’alliage qu’il compose.
De 1797 à 1809 :
- Le poinçon de garantie est une tête de vieillard de face dans un cercle pour le premier titre et un faisceau de licteur pour le second titre. La tête de vieillard est accompagné de numéros correspondant au département dans lequel a été produite la pièce.
- Le poinçon de titre est représenté par un coq dans un cadre à pans coupés, sa tête est tournée vers la gauche. Il est accompagné du chiffre 1 (1er titre, 950e millièmes) ou du chiffre 2 (2e titre, 800 millièmes). Ces poinçons sont valables pour Paris et la province.
De 1809 à 1819 :
- Le poinçon de garantie est un profil de guerrier dans un cercle ; à Paris pour le premier titre il regarde à droite, pour le second titre il regarde à gauche. En province le premier titre est un portrait de vieillard regardant à gauche ; le second titre un homme casqué regardant à droite.
- Le poinçon de titre demeure le coq mais dans un cadre à pans coupés pour les deux titres à Paris mais seulement pour le second titre en province car le premier titre est ici un coq dans un ovale.
De 1819 à 1838 :
- Le poinçon de garantie est une tête de Gorgone de profil pour le premier titre, de face pour le second titre
- Les poinçons de titre sont des profils de vieillard pour Paris et la province ; tournés vers la droite (premier titre) et vers la gauche (second titre).
À partir de 1838, le système se simplifie encore davantage : le premier titre partout en France est insculpté sous la forme d’une tête de Minerve dans un cadre octogonale tandis qu’un cadre légèrement ovale permet d’identifier les ouvrages de second titre.
Enfin depuis 1973, le profil de Minerve est désormais accompagné d’une lettre de l’alphabet changeant tous les dix ans.
À noter également, le vermeil (argent doré) étant composé majoritairement d’argent, il porte les poinçons de ce métal ; il est aussi obligatoirement marqué de la lettre V dans un losange. Les métaux plaqués ont leurs poinçons inscrits dans des carrés ou rectangles à angles droits et vifs tandis que le poinçon au cygne désigne une pièce d’argent d’origine étrangère ou incertaine.
De la même manière que les poinçons sont parfaitement définis et référencés pour l’argent, on en trouvera également réservés à l’or et au platine. Naturellement, ces métaux précieux moins usités dans les arts décoratifs mais le sont davantage dans la bijouterie. Dans les deux domaines, les experts et antiquaires se tiennent à votre disposition et seront toujours heureux de pouvoir vous renseigner. Une bonne raison d’aller les rencontrer…
Marielle Brie de Lagerac
Historienne de l’art pour le marché de l’art et les médias culturels.
Auteure du blog Objets d’Art et d’Histoire
L'auteur, pour la Maison Pipat :
Marielle Brie de Lagerac est historienne de l’art pour le marché de l’art et de l’antiquité et auteur du blog « Objets d’Art & d'Histoire ».
Autres ressources et documentations
24 octobre 2025
Acheter une commode ancienne
Acheter une commode ancienne en toute confiance : styles, indices d’authenticité et pièges à éviter.
21 juillet 2025
Les luminaires anciens : comment sublimer un intérieur contemporain
Qu’ils soient lustres, appliques ou lampes à poser, les luminaires anciens apportent à un intérieur une chaleur singulière, fruit d’anciennes recettes de verre et de cristal.……
28 juin 2025
Les sculptures en plâtre
Longtemps, les éditions en plâtre pâtirent d’une piètre réputation. Considérées comme de vulgaires copies, parfois même rabaissées au rang de création « bon marché », elles eurent…
17 avril 2025
Le mobilier Haute-Époque
Pièces rares et convoitées, les meubles Haute-Époque reviennent en force. Tour d'horizon de ce marché où il est prudent d'être accompagné par un professionnel.
18 mars 2025
Le mobilier en verre de Murano
Depuis le début du XXe siècle, les verriers Murano explorent de nouveaux horizons. Après les luminaires classiques et l'art décoratif, le verre Murano habille désormais le…
3 février 2025
La Foire de Chatou
Rendez-vous incontournable des amateurs d’antiquités et des amoureux du patrimoine français et plus largement européen, la Foire de Chatou est une institution aux origines…