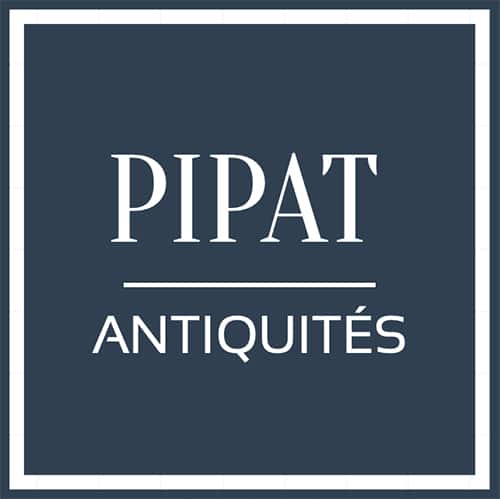Émerveillé par les productions byzantines, l’Occident médiéval explore et parfait dès le VIe siècle un émail cloisonné fascinant, seul capable de rivaliser avec l’orfèvrerie de pierres précieuses. La technique délicate et frugale révèle des couleurs vibrantes aux effets décoratifs somptueux sans avoir à sacrifier une fortune ! L’orfèvre grave son motif sur une plaque de cuivre, d’or ou d’argent dont il prend soin de relever les bords. Puis il soude sur les contours de son motif de fins rubans de métal délimitant des alvéoles. Une fois ce support préparé, il faut fondre la fritte de verre (le fondant) puis la colorée à l’aide d’oxydes métalliques jusqu’à obtenir une riche palette d’émaux opaques ou translucides. L’émailleur n’a plus qu’à verser ces émaux dans les alvéoles de son motif et passer sa plaque au four. Les émaux liquéfiés par la chaleur se solidarisent au métal en refroidissant. Une fine couche de fondant est appliquée pour protéger le métal de l’oxydation puis l’ensemble est poli afin de rendre la surface aussi lisse et brillante qu’une pierre fine.
Un savoir-faire unique
Le Limousin possédait naturellement toutes les qualités pour produire les plus beaux émaux, sa terre produisant tous les éléments indispensables, des oxydes métalliques au sable pour le verre, jusqu’aux métaux précieux. De prolifiques ateliers monastiques élevèrent ainsi cette région au plus haut niveau de l’émaillerie d’art occidentale, et ce pour plusieurs siècles. Sans doute, l’abbaye de Conques puisa dans les savantes techniques limousines lorsqu’elle singularisa sa production de cloisonnés au XIIe siècle. La technique aveyronnaise superpose à un support une seconde plaque ajourée d’un motif. Les cavités formées par la superposition des supports sont enrichies de fins rubans métalliques, comme pour un vitrail. Le cloisonné obtenu est pour l’époque d’une rare et étonnante netteté. Puis au XIIIe siècle, plusieurs foyers de la vallée du Rhin et de la Meuse rivalisent de talent et combinent volontiers émaux cloisonnés et champlevés, on leur reconnait d’avoir en commun une élégante palette froide qui fait alors leurs succès.
C’est cependant dans le Paris du XIVe siècle que l’émail cloisonné atteint un raffinement inégalé de luxe et de délicatesse. Jouant de l’opposition de l’émail translucide et opaque, ces lumineuses pièces parisiennes à fond d’or sont d’une complexité telle qu’elles en seront baptisées : ces émaux dits de plique, empruntent au terme « compliqué ». On cousait probablement sur les vêtements ces petits bijoux éclatants dont la taille n’excédait pas 8 cm. Leurs motifs sont des trèfles, des cœurs et des cercles cernés de cloisons d’or et colorés d’émaux éblouissants. La palette translucide s’étire du rose au rouge et apprécie un jaune pimpant. Les émaux opaques – délimitant souvent l’encadrement – préfèrent le blanc, le rouge brique, le jaune ocre et le bleu cobalt. Ce décor subtil s’ancre le plus souvent dans un fond d’émail translucide vert émeraude qui n’a rien à envier aux joyaux les plus purs.
Le renouveau de l’émail cloisonné
Au XIVe siècle, l’émail cloisonné apparaît en Chine où les pièces les plus précieuses sont créées sous la dynastie Ming (1368 – 1644), à la fin de laquelle la technique parvint au Japon. Ce dernier utilisait comme sa voisine des supports de bronze et de laiton remplacés vers 1880 par le cuivre et le métal blanc, tandis que la colle végétale fut parfois préférée à la soudure pour alléger les pièces d’une production largement destinée à l’export. Car si l’Occident se détourne un temps des émaux européens à l’époque moderne, il est comme envoûté par les émaux asiatiques. On lui pardonne volontiers ce dédain puisque les cloisonnés ressuscitent avec faste dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Comme les émaux médiévaux en leur temps, ces créations européennes d’une grande préciosité entendent rivaliser avec gemmes et joyaux. Les émailleurs russes et scandinaves excellent alors dans ce domaine. Les Norvégiens Jacob Tostrup (1806 – 1890) et David Andersen (1843 – 1901) ainsi que les Russes Ian Khlebnikov (1819 – 1881) ou Pavel Ovchinnikov (1830 – 1888) travaillent pour la noblesse européenne et Antip Kuzmichev (1856 – 1917) fournit la maison Tiffany. Tous produisent vaisselle et objets d’art d’un luxe inouï dans un style opulent et coloré. Leurs émaux cloisonnés sont enrichis de supports guillochés ou garnis de paillons évoquant l’organza. Les couleurs autrefois soigneusement délimitées sont déployées en camaïeux éclatants. Pierre-Karl Fabergé (1846 – 1920) explore toutes les techniques du cloisonné avec une virtuosité prodigieuse tandis qu’en France, Armand Riffault (1832 – 1872), Eugène Feuillâtre (1870 – 1916), Étienne Tourette (avant 1875 – 1924) ou André Thesmar (1843 – 1912) sont les émailleurs talentueux d’une joaillerie renaissante.
René Lalique (1860 – 1945), chef de file de l’émail cloisonné Art Nouveau repoussera les limites d’une variante ardue mais néanmoins exquise des émaux de plique. Dans cette technique dite de plique-à-jour, l’artisan réalise un émail cloisonné sans support métallique pour former comme un vitrail émaillé. Trois manières permettent de parvenir à cette prouesse. La manière russe reproduit le motif désiré en entrelaçant des fils d’or ou d’argent sur une âme métallique. Le grille obtenue est soudée, retirée de son âme puis nettoyée à l’acide pour obtenir un métal blanc brillant. Les alvéoles formées sont émaillées par capillarité puis l’ensemble est passé au four. La manière occidentale remplace la grille russe par une pièce de métal découpée au bocfil, puis émaille par capillarité. Enfin, la manière japonaise couvre un support métallique de plusieurs couches de fondant sur lesquelles sont posées de fines cloisons. On procède alors à un émaillage classique que l’on a soin de protéger d’une couche de vernis résistant au bain d’acide dans lequel la pièce est finalement plongée. Le support est dissout, le vitrail d’émail apparaît. Les émaux de plique-à-jour sont un exploit fragile qui font des pièces antérieures au XIXe siècle des raretés convoitées.
Marielle Brie de Lagerac
Historienne de l’art pour le marché de l’art et les médias culturels.
Auteure du blog Objets d’Art et d’Histoire
L'auteur, pour la Maison Pipat :
Marielle Brie de Lagerac est historienne de l’art pour le marché de l’art et de l’antiquité et auteur du blog « Objets d’Art & d'Histoire ».
Autres ressources et documentations
12 décembre 2025
Les Maquettes de Bateaux
Embarcations fluviales ou maritimes, dimensions imposantes ou miniaturisation, les maquettes renferment tout un monde de voayge !
11 novembre 2025
Les Meubles de Métier
En bois ou en métal, de l'artisan du bois à l'artisan boucher en passant par le mercier ou le drapier, les meubles de métier sont un domaine à part entière de l'antiquité.
24 octobre 2025
Acheter une commode ancienne
Acheter une commode ancienne en toute confiance : styles, indices d’authenticité et pièges à éviter.
21 juillet 2025
Les luminaires anciens : comment sublimer un intérieur contemporain
Qu’ils soient lustres, appliques ou lampes à poser, les luminaires anciens apportent à un intérieur une chaleur singulière, fruit d’anciennes recettes de verre et de cristal.……
28 juin 2025
Les sculptures en plâtre
Longtemps, les éditions en plâtre pâtirent d’une piètre réputation. Considérées comme de vulgaires copies, parfois même rabaissées au rang de création « bon marché », elles eurent…
17 avril 2025
Le mobilier Haute-Époque
Pièces rares et convoitées, les meubles Haute-Époque reviennent en force. Tour d'horizon de ce marché où il est prudent d'être accompagné par un professionnel.