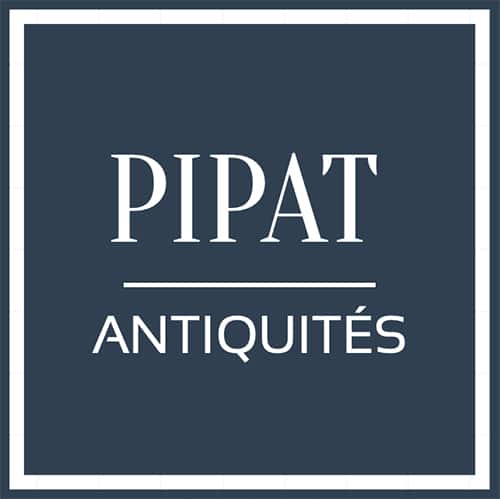La maîtrise technique du matériau et des gestes pour le mettre en œuvre, la capacité à créer directement en plâtre, exigent un véritable savoir-faire artisanal et artistique. Aujourd’hui, les éditions de plâtre font enfin l’objet d’une revalorisation, qu’il s’agisse d’épreuves classiques, étrangères ou purement décoratives.
L’âge d’or du moulage : entre diffusion de l’art et commerce florissant
« Combien de morceaux précieux, dont les amateurs ne sont redevables qu’à l’art de mouler ! » L’exclamation et l’enthousiasme de cet amateur anonyme en 1780 traduit bien l’importance, au regard des connaisseurs et amateurs éclairés, de l’art du plâtre pour connaître la sculpture. C’est alors un moyen aisé et peu onéreux de diffuser les chefs d’œuvre qui sont encore la propriété des rois et de la haute aristocratie.
La Révolution puis les débuts du XIXe siècle ne contredisent pas cet élan, trop heureux de favoriser ainsi l’essor du goût pour l’Antique et de fournir aux écoles d’art des modèles pédagogiques. Le marché du moulage connaît alors une véritable explosion.Des maisons comme celles fondées par Pellegrini Poli ou Mathieu Frediani, installées à Paris dès le début du XIXe siècle, illustrent cette dynamique. On trouve ainsi dans leurs magasins des « figures en plâtre pour décors », des « chapiteaux, bas-reliefs, rosaces, frises », des « Christs, Saints et Vierges pour les églises », ou encore des « moules pour les artistes ». Ces ateliers-magasins proposent un vaste éventail de modèles antiques, religieux ou décoratifs, prêts à orner appartements bourgeois, jardins ou lieux de culte. Les mouleurs italiens dominent ce marché parisien, réputés pour leur grande maîtrise technique qu’ils ont déjà fait connaître par la gypserie.

Des modèles pour tous les goûts
Il est bien connu que le XIXe siècle change de régime aussi vite qu’il change de mode. Après le néoclassicisme cher à l’Empire, on ne jure plus que par les œuvres médiévales et Renaissance à partir des années 1830. Il demeure pourtant une clientèle plus attachée à un style qu’à l’autre et pour satisfaire tous les goûts, les mouleurs diversifient leur offre : réductions, copies d’après gravures, créations originales inspirées de modèles célèbres, voire assemblages créatifs issus du « marcottage » – une technique consistant à recombiner plusieurs éléments de sculptures existantes.
Par ailleurs, si la clientèle est variée en ses goûts et ses moyens, elle est aussi diverses dans sa sociologie. Il semble alors que tout le monde soit susceptible d’acquérir une édition de plâtre. Artistes, amateurs cultivés, décorateurs, institutions religieuses ont leurs besoins, leurs exigences et leurs préférences et dictent les tons de la production. C’est bien cette variété qui masque le caractère sériel de la production, tout en permettant une personnalisation selon les envies (dimensions, patines, etc).

Le plâtre : mémoire du geste artistique
Au-delà même de la reproduction qui semble dominer l’idée que l’on se fait de la production en plâtre, ce dernier joue un rôle central dans la création sculpturale elle-même. Au XIXe siècle, presque tous les sculpteurs, à l’exception des tenants de la taille directe, utilisent le plâtre comme intermédiaire entre la terre modelée et le marbre ou le bronze. Ce matériau, fidèle au geste initial, est souvent le seul témoin de la main de l’artiste.
Auguste Rodin en fait un usage qui nous semble éloquent : le sculpteur fait mouler quotidiennement ses études, de Clemenceau notamment, entre 1911 et 1913, afin de fixer chaque étape de son travail. Ces plâtres, souvent datés, permettent aujourd’hui de « suivre le fil de sa démarche de créateur » rappelle Antoinette Le Normand-Romain, conservatrice et historienne de l’art française, spécialiste de la sculpture du XIXᵉ siècle, et notamment d’Auguste Rodin.
Déclin et oubli au XXe siècle
Disgrâce inévitable après plus d’un siècle d’enthousiasme, le plâtre, matière et forme, est déconsidéré dès le début du XXe siècle. À peine regardé comme des objets secondaires, ces productions sont parfois détruites sans ménagement. L’un des directeurs du Royal Scottish Museum a la formule acerbe, les renvoyant « à la poussière dont ils venaient ».
On leur reproche leur multiplicité face à l’unicité de l’œuvre et la création originale qui doivent primer. S’agit-il d’une réaction épidermique face à la société de consommation qui multiplie par milliers d’exemplaires sans plus aucune considération pour le geste et l’art ? Peut-être.
Pourtant, certains moulages, comme ceux de la Colonne Trajane réalisés avant 1669, demeurent des archives inestimables pour l’étude d’œuvres abîmées par le temps. À ce titre, certains échappent de justesse à des destructions mortifères. En attendant des jours meilleurs…

Le renouveau contemporain : entre mémoire et reconnaissance artistique
Enfin les années 1980 offrir des horizons plus cléments à nos plâtres d’art. En France, en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, un regain d’intérêt se porte sur les anciennes collections de moulages. Les conservateurs et les historiens se penchent sur leur histoire, leur redonnant la valeur qu’elles méritent. Le Victoria and Albert Museum, à Londres, fait restaurer ses fameuses « Cast Courts » à cette époque. Ces salles réunissant une foisonnante collection de plâtres avaient été ouvertes en 1873. À cette occasion, le magazine The Builder comparait leur visite à un premier aperçu du Mont Blanc, créant une de ces « impressions difficiles à effacer ». Et pour cause, une reproduction spectaculaire du David de Michelange ou encore de la colonne Trajane, de la tombe du sculpteur Peter Vischer ou des œuvres de Jean Goujon faisaient – et font toujours – partie des collections.
Peu à peu, les musées réintègrent les plâtres dans leurs expositions, aux côtés des œuvres originales. Ces créations sont à nouveau considérés pour leur qualité, leur technique. Veronika Tocha, de la Gipsformerei de Berlin (l’atelier de moulage des Musées nationaux), rappelle à ce propose qu’« il est possible d’établir des parallèles entre le moulage en plâtre et la photographie, laquelle a aussi longtemps été reçue de manière réductrice, comme le résultat d’un procédé purement technique et un simple moyen de reproduction, pour se voir finalement émancipée de ce type de lecture et être présentée comme une image, et même, plus tard, comme une réelle forme d’art. Ce processus de reconnaissance, dans le cas des moulages en plâtre, n’a toujours pas atteint son terme. »
Il en va aussi de la conservation de certains plâtres comme de la conservation du patrimoine, car ils sont parfois les seuls traces des œuvres originales disparues, comme les moulages de l’église Santa Maria dei Miracoli réalisés avant restauration, sont ainsi devenus les seuls témoins d’un état disparu.

Une valeur retrouvée sur le marché de l’art
Dans le sillage de cette reconnaissance muséale et académique, les moulages retrouvent aussi le chemin des galeries d’antiquaires et des salles de vente. Les grandes maisons telles Sotheby’s, Christie’s, Drouot ou Artcurial proposent désormais des plâtres d’atelier ou des éditions anciennes avec régularité. La provenance, l’état de conservation, la date du tirage ou la filiation avec le modèle original influencent fortement leur estimation et le résultat de la vente.
Du XIXe au XXIe siècles, la sculpture moulée en plâtre a connu plusieurs regards, nombre de contextes et différentes considérations, passant du rang d’outil pédagogique ou décoratif à celui d’objet patrimonial ou artistique. Sa double nature – à la fois trace fidèle et création autonome – fait toute sa richesse. En redécouvrant cette technique, cet art à part entière, les musées, artistes contemporains et collectionneurs participent à redonner toute sa place au plâtre dans l’histoire globale et l’histoire de la sculpture.

Marielle Brie de Lagerac
Historienne de l’art pour le marché de l’art et les médias culturels.
Auteure du blog L’Art de l’Objet
L'auteur, pour la Maison Pipat :
Marielle Brie de Lagerac est historienne de l’art pour le marché de l’art et de l’antiquité et auteur du blog « Objets d’Art & d'Histoire ».
Autres ressources et documentations
12 décembre 2025
Les Maquettes de Bateaux
Embarcations fluviales ou maritimes, dimensions imposantes ou miniaturisation, les maquettes renferment tout un monde de voayge !
11 novembre 2025
Les Meubles de Métier
En bois ou en métal, de l'artisan du bois à l'artisan boucher en passant par le mercier ou le drapier, les meubles de métier sont un domaine à part entière de l'antiquité.
24 octobre 2025
Acheter une commode ancienne
Acheter une commode ancienne en toute confiance : styles, indices d’authenticité et pièges à éviter.
21 juillet 2025
Les luminaires anciens : comment sublimer un intérieur contemporain
Qu’ils soient lustres, appliques ou lampes à poser, les luminaires anciens apportent à un intérieur une chaleur singulière, fruit d’anciennes recettes de verre et de cristal.……
17 avril 2025
Le mobilier Haute-Époque
Pièces rares et convoitées, les meubles Haute-Époque reviennent en force. Tour d'horizon de ce marché où il est prudent d'être accompagné par un professionnel.
18 mars 2025
Le mobilier en verre de Murano
Depuis le début du XXe siècle, les verriers Murano explorent de nouveaux horizons. Après les luminaires classiques et l'art décoratif, le verre Murano habille désormais le…